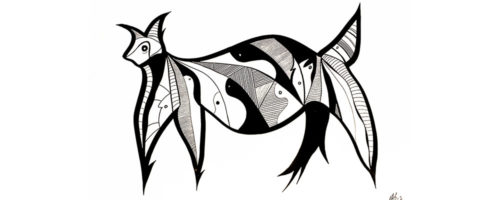Rue Érard, le béton de l’enfance

Je suis né en Janvier 1976. À cette époque, les arrondissements de l’Est parisien achevaient une première mutation. Les industries désertent la ville. Les paysages se transforment en profondeur. Ici et là les étages s’accumulent. Les grands ensembles succèdent aux masures et les classes moyennes aux ouvriers. De cette réorganisation, il ne reste plus que quelques ruelles et passages destinés aux curieux du 21e siècle. J’en sais quelque chose.
Beaucoup de quartiers périphériques furent urbanisés à la va-vite à la fin du XIXe siècle. Paris devait pouvoir gérer l’arrivée en masse de nouveaux arrivants qu’imposaient les chantiers du moment. Ainsi la construction du quartier de Plaisance est la conséquence directe des travaux de l’Exposition Universelle de 1867.
Souvent bâtis avec des matériaux bas de gamme, la plupart de ces immeubles vieilliront mal. Nombre d’entre eux seront déclarés insalubres à partir des années 1950, une aubaine pour les promoteurs. Tolbiac, Place des Fêtes, Nationale, Bercy … Des quartiers entiers finiront rasés au profit d’autre chose. Ateliers et cours pavées laisseront la place aux façades lisses des quartiers d’affaire. Au milieu des grues, subsistent quelques bâtiments en sursis. Leur tour viendra, les tours viendront et quelques dents usées grinceront en vain.
Un jour qu’il fustigeait ce phénomène à la télévision, Leo Malet indécrottable piéton de Paris se vit traiter d’homme du moyen-âge par l’un de ces architectes rénovateurs.
Génération après génération, le mépris de ceux qui savent reste la constante intemporelle de l’équation. Prétentieux et sans âme, certains de ces nouveaux bâtiments peineront à trouver preneur. Par exemple, la désaffection des baby-boomers français pour les tours de la Porte de Choisy donnera naissance au quartier asiatique.
Conscient parfois de trop en faire, certains programmes vantaient leurs mérites de convivialité. C’est le cas de l’immeuble du 11 rue Erard (Paris 12) achevé en 1969, dans lequel je devais passer les 4 premières années de ma vie.
Cette année là, trois architectes dessinent un groupe d’immeubles dans le cadre du programme de rénovation du quartier Saint Eloi. Loin d’imaginer un lotissement banal, le design devait rappeler l’empilement de maisons individuelles. La démarche est sympathique, l’idée bien vendue, mais le résultat un peu vain. L’immeuble évoque un Tétris brouillon.
Nous vivions au second étage, tout de suite à gauche en sortant de l’ascenseur. D’une taille respectable, l’agencement de l’appartement avait été optimisé avec soin. Les pièces à vivre isolées des chambres, respectaient l’intimité de chacun. Idéal pour un jeune couple avec enfants. À la nuit tombée, mon jeune frère et moi restions parfois plusieurs minutes le nez collé aux vitres, fasciné par les scintillements des fenêtres d’en face.
Au rez-de-chaussée se trouvait le fournisseur officiel de mes fonds de culotte, un bazar vestimentaire que nous avions rebaptisé « La dame des pantalons ». J’en garde l’image d’un labyrinthe d’étoffes suspendues. L’atmosphère était sombre et les couleurs mattes. Combien de fois me suis-je débattu au cœur de ces méandres de vêtements tandis que je cherchais à rejoindre ma mère ? Autre temps… je garde le vague souvenir d’une légère fessée administrée par le propriétaire pour cause de trop grande agitation. L’endroit a récemment disparu, absorbé par le local mitoyen. Contre toute attente, cette petite boutique avait survécu des années durant.
L’enfance encore et toujours. Le béton de l’immeuble a imprimé sa marque. Ces blocs empilés complètent mon iconographie seventies : banques aux vitres fumées, téléphones à grosses touches, tapis à poils long, objets pop art, plastique orange et cendriers dans les ascenseurs.
Les appartements sentent le tabac froid. Les chauves ne se rasent pas le crâne, les moustaches occupent les visages et l’on porte encore volontiers la cravate. Beaucoup de trentenaires en paraissaient cinquante.
Un peu plus bas, sur le trottoir d’en face se trouvait un petit magasin Intermarché, dont l’enseigne orange me fascinait. J’y accompagnais souvent ma mère faire les courses. Cette approche parallèle du monde extérieur, me sortait du cocon de ma routine scolaire.
L’endroit n’était pas grand mais il m’arrivait de m’y perdre. À quatre ans, les rayons comme les peurs prennent une autre dimension. À l’évidence « jamais personne ne pourrait me retrouver ». Le plus souvent, la tragédie s’achevait par un «Tu étais la toi ?» au détour d’une allée.
Remise au goût du jour, la superette est toujours là. La mention express a été accolée à l’enseigne. L’ensemble me déçoit. L’éclat de mon souvenir a disparu. Tout semble fade, noyé dans une triste enfilade. Qu’importe… Planté à quelques mètres de l’entrée, je me perds dans d’inutiles mélancolies. Les portes coulissantes viennent de laisser entrer une mère et son enfant. Je souris en songeant qu’à cet instant précis, le petit n’imagine pas les dangers que ce labyrinthe lui réserve. Sans doute dans trente ans, écrira-t’il la suite de ce chapitre.
Nicolas Bonnell